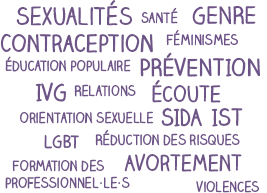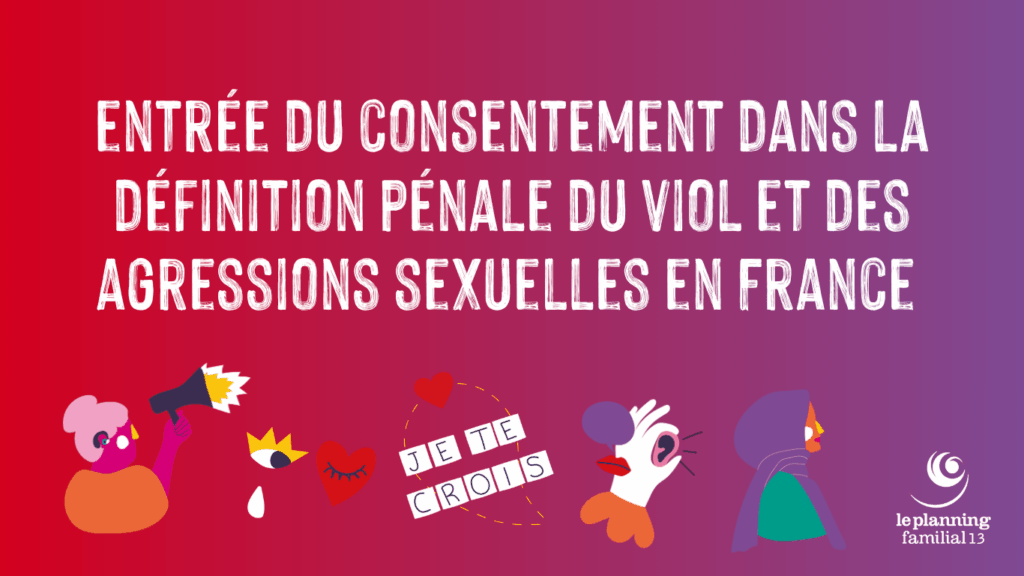
Un jour historique pour la lutte contre les violences sexuelles
Ce mercredi 29 octobre, la notion de non-consentement a été officiellement adoptée par le Sénat dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles en France. Les résultats sont sans appel : 327 voix pour ! Seuls les élus d’extrême droite s’étaient opposés au texte à l’Assemblée nationale.
L’amendement de ce texte, porté par les députées Véronique Riotton (Renaissance) et Marie-Charlotte Garin (Les Écologistes), et soutenu par Aurore Bergé, ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, marque un tournant historique dans la reconnaissance des violences sexuelles.
Il vient acter l’obligation d’un consentement libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable, qui ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime dans la définition du viol et des agressions sexuelles.
Une redéfinition en accord avec l’Europe
Désormais, le viol est défini par « tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui sans son consentement ».
Formulée de la sorte, la charge de la preuve est renversée : il ne s’agit plus pour la victime de prouver qu’elle a manifesté son refus, mais pour la personne accusée de démontrer qu’il ou elle a obtenu un consentement clair. La même logique est appliquée à la définition des agressions sexuelles, à la différence qu’il s’agit d’atteintes sexuelles sans pénétration.
C’est un changement fondamental, puisqu’il rejette l’idée qu’une absence de résistance équivaut à un consentement et reconnaît le phénomène de sidération qui touche de nombreuses victimes.
Cette proposition de loi modifie l’article 222-22 du Code pénal, qui jusqu’ici qualifiait le viol sur la base de quatre critères : la présence de violence, de menace, de contrainte ou de surprise. Grâce à l’ajout du consentement dans la définition du viol, la France s’aligne sur d’autres pays européens (Suède, Espagne, Royaume-Uni, etc.) qui avaient déjà intégré cette notion, et se conforme à la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée en 2014.
Visibiliser et légitimer les victimes
C’est une « victoire collective », se réjouit la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. De son côté, Émilie Bonnivard (Les Républicains) souligne que « l’agresseur présumé devra désormais apporter des éléments démontrant qu’il s’est enquis du consentement de la victime », l’objectif étant de mieux protéger les victimes et de les encourager à porter plainte.
En effet, chaque année en France, environ 153 000 personnes majeures sont victimes de viols et 217 000 d’agressions sexuelles. Pourtant, seulement 6 % d’entre elles déclarent avoir porté plainte. Le taux de classement sans suite peut décourager : 94 %, selon une étude de l’Institut des politiques publiques de 2024.
Des études menées dans les pays ayant déjà adopté une définition similaire montrent une augmentation du taux de condamnation pour viol. Bien que cette évolution soit progressive et dépende de la formation des acteurs et des actrices judiciaires, elle reste significative. Par exemple, la Suède a enregistré une hausse de 75 % des condamnations pour viol dans les années suivant sa réforme.
Ce texte nous fait « passer de la culture du viol à la culture du consentement », selon Aurore Bergé, un fait important à noter et qui avait déjà été dénoncé lors du procès des viols de Mazan il y a presque un an.
Durant ce procès, de nombreux sujets avaient été abordés : le viol conjugal, la banalité des profils des violeurs, le phénomène de la soumission chimique… Gisèle Pelicot et son avocat ont pu mettre en lumière les propos et comportements qui minimisent, normalisent, voire encouragent le viol. Ce procès a constitué un moment clé dans la prise de conscience du grand public sur les violences sexuelles et a sans doute contribué, indirectement, à l’adoption de cette nouvelle loi.
Pour aller plus loin :
> Consultez la campagne nationale d’information sur le consentement menée par le Gouvernement français et le Secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, également relayée sur les réseaux sociaux avec le hashtag #LeConsentementÇaCompte.
> Lisez la page dédiée au consentement sexuel sur Service-Public.fr, qui détaille le cadre légal, les droits et les ressources d’aide disponibles.
> Découvrez le court-métrage « Je te tiens » de Sergio Guataquira Sarmiento (France.tv Slash), qui aborde avec justesse les zones grises du consentement à travers une mise en scène délicate et poétique.